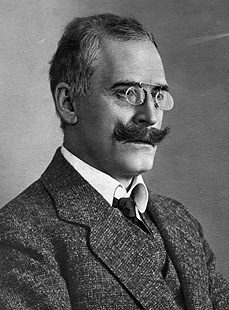Mon premier contact avec le professeur Rachel Winslowsky, de l’université de Vienne, remontait à la fin de l’année mille neuf-cent trente-deux. Professeure de philologie, éminente folkloriste et anthropologue, elle revenait d’un voyage dans les Carpates de l’actuelle République socialiste roumaine. Par une longue lettre, elle me racontait son expérience au sein d’une communauté de hameaux, perdue dans les neiges plus de quatre mois dans l’année. Quoique déformés et dégénérés d’apparence par la consanguinité, ces gens semblaient plutôt pacifiques et craintifs. Aucun culte moderne- le professeur entendait par là : abrahamique- ne semblait leur être connu. Quoique non pratiquante, elle s’était présentée à eux comme juive, son étoile de David autour du cou. A l’inverse de la plupart des paysans de Roumanie et d’Europe Centrale en général, ils n’avaient manifesté aucune hostilité : leurs yeux étaient demeurés, écrivait-elle, vides et presque compatissant. Elle semblait ne pas comprendre d’où venait cette étrange compassion, cette barrière du temps, de l’espace et de la pensée qui la séparait de ces paysans incultes, non idiots, mais qui avaient établi une proto civilisation, une proto histoire, et parlaient un langage étrange, bricolé, volé.
Il était inutile de mentionner que les troubles économiques, politiques et sociaux qui traversaient alors leur pays- dont ils ignoraient jusqu’au nom- leur étaient aussi inconnus que s’ils avaient été animaux. Elle évoquait ensuite dans sa lettre les détails qu’elle avait pu saisir de leur culte primitif et quasi préhistorique. À chaque lune noire, hommes et femmes se réunissaient autour d’une idole de pierre étrange, vaguement anthropomorphe. Quoique n’étant pas géologue de formation, elle disait assurer qu’il ne s’agissait pas d’une pierre terrestre. Elle avait pu assister à deux de ces cérémonies, qui l’avaient plongée toutes deux dans un profond malaise. Au cours de cette cérémonie, les participants, nus, dansaient en poussant des hullulements qu’elle disait n’avoir jamais entendu sortir une gorge humaine ou animale. La deuxième cérémonie fut celle de trop, et elle prit congé de ses hôtes, en compagnie du guide qui l’accompagnait, un ancien braconnier borgne flanqué d’un énorme chien de berger turc. Elle prit le premier train de Bucarest à Vienne, où elle m’écrivit la lettre que je tenais entre les mains.
La lettre suivante du professeur Winslowsky ne vint qu’en avril mille neuf-cent trente-trois. Comme je m’y attendais, et malgré le faible attachement à la communauté qui était la sienne, elle évoquait rapidement ses craintes concernant la situation en Allemagne, si proche de l’Autriche qu’elle aimait tant. Elle me fit part de son départ dans les deux mois pour New-York, où vivait déjà une partie de sa famille. Elle avait par ailleurs pris le temps d’approfondir ses recherches sur l’étrange communauté de Roumanie. D’après elle, d’autres cultes primitifs de ce genre existeraient à travers le monde, en Laponie, dans le Caucase, dans les Highlands, dans l’Himalaya, et même en Amérique. Elle avait joint à sa lettre un certain nombre de croquis : on y trouvait un portrait d’une de ces femmes roumaines (si tant est que le concept de nationalité s’appliquât à pareille créature). La bouche fermant mal, la peau ridée, les cheveux en bataille, un œil exorbité, et un moignon à la place de la main droite, voilà ce que le professeur Rachel Winslowsky avait dessiné. Elle avait en outre ajouté comme commentaires en allemand : « âge estimé : vingt-cinq ans, odeur épouvantable ». Le second croquis était celui de la fameuse idole. Il s’agissait d’une pierre de couleur bleue irisée, taillée ou fondue en forme d’humanoïde grotesque, assis sur les fesses, sans cou, avec des yeux globuleux et des mains griffues. Là encore, il y avait un commentaire indiquant sa taille : six mètres.
En attendant son arrivée aux États-Unis, elle m’avait fourni quelques indications sur la possibilité d’un culte plus ou moins semblable, vivant quelque part dans le Colorado. Il s’agissait donc probablement d’Amérindiens. Étant au courant de l’état de santé précaire qui m’obligeait à tenir le lit, elle avait prévu de s’y rendre après un passage à Leadville.
*****************
Journal du professeur Winslowsky
9 avril 1933
J’ai pris contact avec le professeur Northon, et lui ai communiqué mes notes sur mon voyage en Roumanie. Je noterai ici l’intégralité de mon aventure américaine. Depuis mon départ de Vienne pour Bucarest, un sentiment étrange me tient et ne me lâche pas le cœur, comme si j’étais suivie par un animal. Ce sentiment s’est accru après mon départ de l’étrange culte primitif dans les Carpates, et plus encore à mon arrivée à Bucarest. Doucement, progressivement, ce malaise a crû. Pour européenne et belle qu’elle soit, la capitale roumaine est une ville étrange et magique, empreinte d’orient.
J’ai pris les mêmes vêtements et le même équipement que pour les Carpates : bottes fourrées, piolet, manteau, gants, écharpe, carnet de croquis, ainsi qu’un révolver ayant appartenu à mon père, officier dans l’armée austro-hongroise. Par précaution, j’ai choisi de passer par la Suisse pour gagner la France, d’où j’embarquerai pour les États-Unis.
12 avril 1933
Je suis à Bordeaux et j’attends le bateau qui doit partir d’ici quelques jours. L’impression d’être suivi depuis Bucarest ne disparaît pas. Vienne me manque. Il émane de la France et des Français, malgré les tensions sociales et politiques, une joie de vivre qu’on ne retrouve pas à l’est de l’Europe, si mélancolique. Sans doute le catholicisme a-t-il contribué à ceci, mais il y a évidemment autre chose car on ne saurait qualifier les Polonais de joyeux- du moins, pas comme le sont les Français.
Je continue de lire sur le culte du Colorado que j’espère découvrir. Il semblerait que ce soit des trappeurs accompagnés d’un prêtre qui les aient découvert en perdant leur chemin, au XVII ème siècle. D’après les notes que j’ai, il semble qu’il y ait la présence du même type d’idole anthropomorphe qu’en Roumanie, ainsi que des danses nues à la même occurrence, soit une fois par mois; probablement à l’occasion de la lune noire. Les trappeurs ne semblent pas être restés longtemps, et se sont rapidement enfuis, pris du même malaise que moi. Si cette divinité primitive liait tant de cultes d’un bout à l’autre du globe, quelle était elle ? Et par quel moyen ?
14 avril 1933
Je suis arrivée à New-York, où mon oncle m’attendait avec sa voiture. Les effusions familiales m’ont toujours mise mal à l’aise. J’ai donc prétexté une fatigue pour m’isoler et continuer à lire et à écrire, seule.
J’ai pris le temps d’envoyer un télégramme à Leadville afin de trouver un guide susceptible de m’emmener dans la montagne. J’ai beau avoir l’esprit aventurier, je n’ai pas envie de risquer dans des endroits que je connais encore moins que les Carpates.
15 avril 1933
J’ai pris le train pour Leadville. En m’installant dans le wagon, déjà occupé par trois soldats qui rentraient en permission, le sentiment qui me suit depuis la Roumanie est devenu un poids, un étau. Je tâche de ne plus y penser. La route est longue jusqu’au Colorado et ses montagnes.
*****************
La mi avril était déjà passée et je n’avais plus de nouvelles du professeur Winslowsky. Je ne m’inquiétais cependant pas outre mesure : je savais qu’elle devait prendre un train jusqu’à Leadville, fort éloignée de New-York, où vivait sa famille. De mon côté, coincé à Baton Rouge, j’étais obligé d’attendre de ses nouvelles. J’avais pour ma part fait venir un certain nombre d’ouvrages sur des cultes qui pourraient ressembler à ce qu’avait découvert le professeur Winslowsky. Quelques lignes en particulier dans l’ouvrage d’un archéologue et alpiniste de la fin du siècle précédent étaient intéressantes. Elles évoquaient un culte de cannibales, vivant quelque part dans le Caucase, et vénérant une statuette de pierre irisée vaguement anthropomorphe, et dansant nus à chaque lune noire. L’auteur, devenu quasi fou après cette rencontre, avait confiné ces lignes dans l’ouvrage que je tenais en main, avant de s’isoler dans la cellule d’un starets proche du cercle arctique.
Je ressentais depuis quelques jours un vague malaise dont je ne parvenais pas à trouver l’origine. Sans doute la persistance de la position allongée, couplée à la fièvre devait elle jouer tant sur mon psychisme que sur mes douleurs physiques. Je faisais des rêves étranges, de lunes jumelles et bleuâtres au dessus de pics enneigés, dans des ciels balayés par des aurores boréales.
*****************
18 avril 1933
Je suis arrivée à Leadville, où j’ai pu envoyer un télégramme au professeur Northon. Même si nous sommes au printemps, le climat est bien différent de celui de New-York. Curieusement, je me sens mieux ici que là bas, d’ailleurs, dans cette ville minière à l’architecture victorienne, perchée à trois mille mètres d’altitude. J’ai trouvé Jeremiah, le guide amérindien qui m’attendait à l’hôtel. Sourire bienveillant, petite taille, cheveux très noirs. Il est né dans une réserve mais parle un anglais impeccable ainsi que le français. Quand je lui ai parlé de l’objet précis de ma visite, son visage s’est fermé. Il m’a fait comprendre qu’il me guiderait, ce pour quoi il est payé, mais qu’il n’irait pas au bout. Je ne suis pas rassurée je dois l’admettre. Nous partons demain à sept heures du matin.
19 avril 1933
Nous sommes partis très tôt avec des chevaux frais, en direction des montagnes. Nous sommes rapidement retrouvés dans une sorte de vallée, entouré de pics déchirés, de moyenne hauteur. Nous nous sommes arrêtés peu avant midi pour prendre un rapide en-cas. Puis nous avons repris la marche. Le soleil peine à filtrer à travers les pics et les arbres. Le faux plat du chemin s’est transformé en montée franche. Les terriers d’animaux sont rares, les oiseaux ne chantent pas. La mousse ne pousse ni sur les pierres ni sur les arbres. Comme en Roumanie, la nature même semble transformée. On dirait qu’elle vit et se retire, à la façon d’une araignée, terrifiée par quelque force étrangère. Nous poursuivons notre marche pendant plus de deux heures. Le soleil décline. C’est la que Jeremiah m’a laissée. J’en profite pour écrire ces quelques lignes avant de continuer seule.
*****************
Je n’avais plus de nouvelles du professeur Winslowsky depuis son télégramme de Leadville lorsque je reçus une visite. Carl mon domestique m’annonça quelqu’un qui voulait me parler personnellement et qui semblait agité. Je le fis installer dans l’entrée de la maison, et descendit à grand peine. Une fois en bas, je pus découvrir notre mystérieux visiteur : il s’agissait d’un Amérindien portant un costume trois pièces, bien coiffé. Portant une petite valise en main, il baissait la tête. Quand je lui demandai l’objet de sa visite, il dit s’appeler Jeremiah. Il sortir de sa valise ce qui ressemblait à un livre… Ou un journal de bord. Jeremiah me le tendit. C’était celui du professeur Winslowsky.
Je commençai ma lecture et au bout de quelques pages, le journal me tomba des mains d’horreur. Après son arrivée à Leadville, le professeur Winslowsky avait été guidée dans la montagne par Jeremiah. Ce superstitieux idiot l’avait abandonnée peu avant ce qui allait s’avérer être le lieu de vie du fameux culte des montagnes. Quand elle y arriva enfin, à la tombée de la nuit, elle découvrit une communauté d’humains quasi préhistoriques, difformes et dégénérés, à la langue gutturale et hullulante à la fois, et vêtus de peaux de bêtes seules malgré le froid évident. Et puis, il y avait cette idole anthropomorphe monstrueuse, faite d’une matière irisée, non terrestre (elle avait souligné ces deux mots). Ce qui la frappait, écrivait elle, est que ces hommes et ces femmes étaient de race blanche, quoiqu’elle décelât un léger métissage avec des Amérindiens. Cette communauté, écrivait-elle, n’était elle finalement pas si repliée sur elle-même ? De la même manière qu’en Roumanie, elle reçut un accueil à la fois primitif et naïf, de la même manière que des chiens ou des singes accueillent les hommes. Sans doute, disait elle dans ce journal du dix-neuf avril, étaient ils si peu habitués à la civilisation qu’ils avaient gardé cette naïveté sauvage que l’on attribue d’ordinaire au penseur suisse Jean-Jacques Rousseau sous le nom du bon sauvage.
Le lendemain, notait elle, ces sauvages se mirent à beaucoup s’agiter. L’idole monstrueuse en particulier fut le centre de toutes les attentions. Elle fut couverte de sang, de plumes d’oiseaux, de petits cailloux et de branchages. Cela ressemblait, notait elle, à une espèce de célébration annuelle- probablement un rite lié au printemps et à la fertilité.
Elle racontait ressentir des fièvres, des nausées, et rêver de plus en plus d’une présence qui la suivait depuis la Roumanie. Elle évoquait des rêves de lunes bleuâtres et d’aurores boréales. J’en fus troublé, car cela ressemblait beaucoup à ce que je vivais en ce moment, bien que cela était probablement une coïncidence. Elle évoquait une espèce d’attirance mêlée de répulsion pour l’idole des sauvages, un sentiment presque sexuel, primitif, associé à des bouffées de chaleur. Ce même jour, le vingt avril, une espèce de sorcier était venu la trouver dans la hutte qu’ils lui avaient donnée. Marmonnant des genres d’incantations, il lui avait donné un bol plein d’une soupe étrange qu’elle avait bue. Après un sommeil dont elle ne pouvait mesurer la durée, écrivait elle, elle s’était mise à vomir. Puis à nouveau, elle s’était évanouie, tombant dans une espèce de transe où elle voyait toujours ces deux lunes bleuâtres, les pics enneigés, et des aurores boréales. A son réveil, épuisée, elle était pleine d’un désir sexuel qu’elle même n’expliquait pas. Elle avait eu le temps de noter ces quelques lignes d’une main fébrile. Son récit s’achevait là. Craignant le pire, quant au dénouement, je me tournai vers Jeremiah, lui demandant comment il s’était procuré ce journal. Ne la voyant pas revenir, il avait bravé sa peur, et s’était aventuré vers le village. Là, ce qu’il avait vu l’avait proprement terrorisé : autour de l’immonde idole de pierre, sous un ciel d’encre, deux lunes bleuâtres semblaient être un regard maléfique sur la cérémonie en cours. Les sauvages, nus et hullulant leur monstrueux cris de joie, dansaient autour, chantant et criant. Sur un autel primitif de pierre, décoré de feuilles et de branchages, le professeur Rachel Winslowsky était étendue nue, jambes écartées, yeux révulsés, glapissant comme ses monstrueux hôtes. Mais le pire était l’abomination qui était en train de s’accoupler avec elle : pas tout à fait humain, il avait, me dit mon interlocuteur, des pattes plus que des mains, avec six doigts, une trompe caoutchouteuse, gigantesque, et était couvert d’une fourrure d’un brun sale, épaisse comme celle d’un sanglier. Jeremiah, les yeux mouillés de colère et de tristesse, n’eut que le courage et la présence d’esprit de prendre le journal que je tenais en main et son collier, auquel pendait une étoile de David.