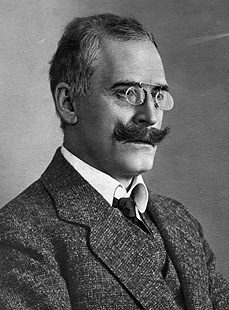Dans les premières décennies de l’empire séleucide, né des ruines de l’empire d’Alexandre le grand, régna Bérénice Syra, reine lagide, et seconde épouse de Antiochos II. Lors du mariage, qui scella l’alliance nouvelle entre l’empire séleucide et le royaume lagide, elle emmena avec elle sa servante, une helleno-perse nommée Demestis. C’était une jeune fille de dix neuf ans, aux cheveux et aux yeux noirs, aux hanches larges. Sa peau était pâle, comme toutes les grecques qui ne quittaient jamais le confort et la sécurité d’un palais. Elle avait les fesses généreuses juchées au sommet de jambes interminables, ce qui la rendait aussi grande que bien des soldat de l’armée de sa maîtresse, et plus grande que bien des Perses. Si l’on ajoute à cela sa poitrine opulente, on imagine aisément que bien des hommes n’osaient et ne pouvaient la regarder dans les yeux sans rougir voire défaillir. Et pourtant, Demestis désespérait, se languissait d’aimer ! Depuis ses douze ans, elle accompagnait sa maîtresse, dans ses bains, ses repas, et ses divers moments d’intimité. Elle lui faisait la lecture, la coiffait, et était devenue peu à peu sa confidente en tout domaine… Y compris celui des hommes. Demestis en savais bien sûr moins que sa maîtresse, et sa connaissance des choses de l’amour se limitait aux textes de Sappho, d’Aristote, d’Agathon ou les comédies d’Aristophane; ce qui était bien mince.
Plus d’une fois, elle avait soupiré pour un esclave, un soldat ou un ambassadeur, sans réellement comprendre le trouble qui envahissait alors son cœur et son corps, les vagues de chaleur qui l’emportaient.
********************
Au moment où commence notre récit, Demestis était en train de préparer un bain pour sa maitresse. Sous l’œil indifférent des eunuques, elle versait lotions et parfums dans la baignoire de pierre. Elle y plongea un bras mince et pâle, afin de s’assurer que la reine ne s’y brûlerait pas. Puis elle alluma un peu d’encens, et s’assit sur un petit fauteuil grec aux pieds ornés de tête de lions.
La reine Bérénice ne se fit pas attendre, et entra bientôt dans la pièce inondée du soleil de juin, accompagnée de deux suivantes plus jeunes que Demestis. Elles portaient des plateaux chargés de fruits, de biscuits, pour la première, et un tambûr assyrien pour la seconde. S’agenouillant de part et d’autre du bassin, elles attendirent, tête légèrement penchée. Seule Demestis regardait avec un mélange de fascination, d’envie et de désir mêlés sa maitresse ôter son chiton rouge qu’elle portait simplement, avec une ceinture décorée d’or et de rubis. La respiration de Demestis se fit plus saccadée quand la reine dévoila sa poitrine rose et menue, puis son ventre légèrement rebondi, et enfin son sexe dont elle avait fait ôter les poils par Demestis. Celle-ci se remémora chaque instant de ce moment d’intimité, chaque coup de ciseaux passé dans la noirceur touffue de sa maitresse, l’odeur forte et délicate tout à la fois qui s’échappait de cette fleur douce, le regard tendre et autoritaire qu’avait posé la reine sur elle, ainsi que les contractions violentes qui avaient secoué ses entrailles la nuit suivante.
Les premières notes du tambûr tirèrent Demestis de sa rêverie. La reine avait plongé dans l’eau, les yeux fermés. Seules émergeaient sa tête et ses épaules, tandis que son abondante chevelure d’ébène semblait lui faire une couronne. Distraitement, elle prit quelques grains de raisins sur le plateau à sa droite, et les avala d’une traite. Les volutes d’encens, la musique lancinante, la reine dans son bain, formaient ensemble pour Demestis un spectacle des plus savoureux.
Bérénice sortit son pied luisant de la baignoire. Demestis se précipita pour la masser, avec tendresse et science. Passant ses doigts dans les creux et sur les aspérités douces, elle semblait dévorer du regard le pied de sa maitresse, comme un artisan fasciné par l’objet qu’il crée. Elle passait ses doigts entre les orteils, l’eau coulant le long de ses mains et de ses poignets. Puis elle passait l’éponge le long du pied et de la cheville de la reine, qui lui répondait par des soupirs et des gémissements, auxquels Demestis répondait en silence par les mêmes secousses dans son bas vas ventre. Le visage de la jeune fille était si proche des pieds de la reine qu’elle pouvait les sentir, les effleurer, presque les embrasser. Au fond de son ventre et de son cœur grandissait la tentation de poser ses lèvres sur la pulpe du pied qu’elle tenait de ses doigts de jeune fille.
********************
La chaleur nocturne de l’été mésopotamien entrait par une fenêtre dans la chambre de Demestis. Alanguie sur un lien bien trop grand pour sa solitude, son esprit et son corps étaient tourmentés, plongés dans le feu. Une main plongée entre ses cuisses voluptueuses, l’autre allant de l’un à l’autre de ses seins immenses et pâles, elle revoyait son après-midi en compagnie de sa maîtresse, par éclats lumineux et flous. Maladroitement, elle fouillait de ses doigts minces à l’intérieur de son sexe rose et humide, aux lèvres épaisses et luisantes de désir, et que surplombait un triangle de peau légèrement plus sombre, habitué qu’il était d’accueillir une épaisse forêt de poils drus et frisés. Mais Demestis, à l’instar de sa maitresse, ôtait régulièrement ces poils, suivant l’usage perse, ce qu’elle faisait à l’aide de la flamme d’une lampe, à la façon des Grecs. Elle avait à présent enfoncé deux doigts en elle, ce qui lui arrachait des soupirs qu’elle étouffait en se mordant la lèvre inférieure, tandis qu’instinctivement, son autre main vint chercher son petit bouton, déjà gonflé. Sa respiration se fit alors plus rapide, saccadée, et devint gémissements. N’y tenant plus, elle commença à effleurer d’un de ses doigts encore libre son minuscule trou, étroit et sombre. Saisissant une bouteille d’huile sur la table à côté de son lit, elle en versa au creux de sa main, avant de l’étaler sur les bords de cet endroit que jamais encore elle n’avait osé toucher. Puis, avec une précaution et une douceur infinies, elle entra, lentement, une phalange après l’autre. Et quand enfin elle fut entrée, son plaisir ne connut plus de bornes, ses doigts travaillant de concert pour la faire gémir de toutes ses forces. Elle dut se coucher sur le ventre, et mordre ses draps pour ne pas hurler.
********************
Demestis se leva près de deux heures avant le lever du soleil. Elle fit quelques rapides ablutions, se parfuma, et s’habilla d’un chiton blanc. Elle ne portait pour bijou qu’une fibule en argent et un collier en or. En outre, elle allait le plus souvient pieds nus, pour le plus grand plaisir de Davaman, le chef des eunuques. Privilégié parmi les privilégiés, ce mercenaire maurya d’à peine dix-huit ans était le seul à ne pas être eunuque. Immense, le teint légèrement hâlé, absolument glabre et arborant des yeux vert profond, ce féroce guerrier était tout à la fois gardien, ambassadeur, et confident pour Demestis. Infaillible et imperturbable, sa seule faiblesse était les pieds de Demestis, dont la vue le troublait grandement, ce qui amusait grandement la jeune femme.
Tandis que Demestis faisait la lecture à Bérénice, Davaman entra dans la pièce, accompagné d’un eunuque au visage de pierre. Il dut dissimuler son trouble en voyant les pieds de Demestis, repliés sous les jambes de celle-ci, pour annoncer l’arrivée du roi. Demestis se mit à genoux, tête baissée, tandis que la reine restait assise, tête baissée également. La taille haute, le profil dur, le nez droit quoiqu’un peu court, les cheveux d’ébène et bouclés, vêtu d’un lourd manteau de pourpre par dessus son armure, l’épée au côté, il était suivi de deux argyraspides, couverts de poussière et de cicatrices, ainsi que d’un troisième guerrier.
Celui-ci n’était à coup sûr ni un grec, ni un perse. Plutôt trapu, l’œil féroce mais le port de tête altier, il avait rangé son large bouclier rond dans son dos, et portait au côté un kopis. D’une main, il tenait un lourd sac de toile qu’il avait renversé sur une épaule. Il fut introduit par le roi lui-même en ces termes : « Ma reine, voici Mirigade, d’Arménie. Il sera ton garde du corps personnel. Je pars prochainement pour la lointaine Thrace, et je ne souffrirais qu’il t’arrive malheur si la guerre dégénérait ». Celle-ci eut une brève inclination de remerciement, tandis que Mirigade s’avançait vers elle. Il fit une profonde révérence : « Mon bras est à votre service, ma reine » clama-t-il.
Le roi salua brièvement sa femme, avant de tourner les talons. Il disparut accompagné de ses soldats. Mirigade demeura seul, comme une statue, face à la reine, le visage impassible.
********************
Au fond de son lit, Demestis avait une fois de plus chaud. Mais ce n’était pas la lourde nuit mésopotamienne qui emplissait la pièce par la fenêtre, se glissait sous ses draps, entre ses jambes, et venait remuer ses entrailles. C’était un sentiment nouveau, plus qu’une sensation. Au désir qu’elle connaissait déjà pour les femmes, et notamment pour sa maitresse, venait d’éclore, telle une fleur, quelque chose de nouveau, de primitif, et de violent. Elle n’avait pas de mot pour le nommer, en grec, en araméen, ou en vieux persan, seulement des sensations et des couleurs au fond de son cœur et de son esprit enfiévré. Mais au milieu de cette tempête d’interrogations et de doutes, un nom au moins émergeait : Mirigade. Si elle ignorait la nature de son trouble, elle en connaissait au moins la cause. Et malgré sa jeunesse et son inexpérience, elle savait que ce mercenaire barbare des montagnes du Caucase allait jouer un rôle dans sa vie, elle qui était une fille de Bactriane, enfant d’un soldat grec et d’une courtisane perse.
Comme la nuit précédente, elle eut envie de se caresser, de se toucher, d’explorer son corps. Elle n’était qu’albâtre en fusion, réclamant la caresse délicate quoiqu’encore maladroite de ses doigts. A nouveau ses doigts se perdirent entre ses jambes, cherchant la source d’une soif nouvelle et jamais complètement assouvie, tandis qu’elle soupirait et gémissait, son autre main caressant tour à tour ses hanches, ses seins ou son ventre. Pendant de longues minutes, ses caresses lui arrachèrent des bruits de toute sorte, certains qu’elle se connaissait, et d’autres nouveaux, grognements, feulements, tandis qu’elle se griffait les épaules et les flancs. Elle enfonçait à présent un, deux puis trois doigts dans son anus largement ouvert, ses fesses dressées, ouvertes en cadeau aux dieux et à la chaleur de la nuit. Chaque extase ne la fatiguait pas, mais bien au contraire la rendait plus affamée, de sorte que ses caresses se faisaient plus intenses, plus fortes, plus profondes en elle. Et au fond de ses draps, Demestis toujours gémissait, soupirait le nom de Mirigade.
********************
Emergeant d’un sommeil ouaté et poudreux, Demestis constata avec panique que le soleil pointait déjà ses rayons roses et dorés à travers sa fenêtre. Elle s’habilla à la hâte et courut préparer le bain de la reine. Quand celle-ci entra dans la pièce, elle remarqua que sa suivante était rouge de confusion et essoufflée d’avoir couru à gauche et à droite. Elle s’en étonna et lui en demanda la raison. S’inclinant profondément, Demestis lui répondit qu’elle avait eu une nuit agitée, et qu’elle s’était réveillée tard. Bérénice eut un sourire rassurant avant de plonger dans l’eau. Comme la veille, les deux autres servantes se tenaient de part et d’autre de la baignoire, l’une avec un tambûr, l’autre avec un plateau de fruits. Demestis s’enquit de l’absence de Mirigade, provoquant chez sa maitresse un sourire à la fois attendri et curieux. Elle lui dit alors d’aller de prendre le vestibule derrière, puis de se rendre aux cuisines. Là, elle préparerait un plateau de fruits, une œnoché de vin et de l’huile d’olive. Puis elle irait dans la chambre de Mirigade, et le masserait. Le rouge monta légèrement aux joues pâles de Demestis. Elle se leva et glissa jusqu’aux cuisines. Les tables, les dessertes croulaient de plats remplis de fruits, d’olives, de poissons de toute sorte, de volailles, de confiseries, de jarres de toute formes, pleines d’huile, de vin, de vinaigre, et grouillaient de personnels des deux sexes, hurlant, s’insultant, et d’animaux, chiens, chats, volailles en liberté. Il émanait de l’endroit un chaos sonore, visuel et olfactif, sans cesse renouvelé, qui enchantait Demestis chaque fois qu’elle venait. Souvent, elle venait saluer Hypomaque, le chef saucier, un vieil homme borgne à la barbe grise et à la voix tonitruante. Se frayant un chemin entre un esclave portant un plat de dattes et une poule qui courait devant une cuisinière en caquetant, Demestis transmit les ordres de la reine. Aussitôt, une armée de serviteurs de toutes couleurs se mirent en branle, courant de droite et de gauche. En un instant, la volonté de Bérénice avait été exécutée. A présent les bras chargés, Demestis se mit en marche vers la chambre de Mirigade. Si elle était rompue à l’exercice du port de charges lourdes ou mal équilibrées, elle n’en était pas moins inquiète à chaque fois à l’idée de renverser quelque chose. Tenant le plateau d’une main, fermement maintenu contre la hanche, elle allait, dodelinant, l’œnoché dans l’autre main, tandis que la petite jarre d’huile était délicatement et dangereusement posée sur le plat de fruits. Celui-ci semblait vouloir inonder le couloir de dattes, raisins, châtaignes, faînes grillées, pêches, figues, son odeur douce et sucrée montant aux narines de Demestis. Elle arriva bientôt à la chambre de Mirigade. Penchant la tête à travers l’ouverture, elle constata que le guerrier arménien dormait profondément sur le ventre, la tête tournée vers la fenêtre ouverte. Posant le vin juste à l’entrée, elle déposa délicatement le plateau sur la petite table de bois à côté du lit, avant de laisser ses sandales à l’entrée. Elle alla ouvrir légèrement la fenêtre, en silence, pour faire entrer un peu d’air et de lumière. En même temps, elle observait discrètement Mirigade : musclé, le corps couvert de cicatrices aux épaules et aux bras, il arborait notamment à l’arrière du bras une immense balafre que le temps avait mal soigné. Demestis rougit : elle le trouvait beau. Beau, mais odorant : il y avait sans doute un moment que cet Arménien venu du fin fond du Caucase, à travers la Syrie et la moitié de la Mésopotamie, n’avait pas pu prendre un bain. Dans son sommeil, il poussa un petit grognement, et se tourna sur le côté. Demestis réprima un cri de surprise : Mirigade était totalement nu, son sexe pendant mollement entre ses cuisses velues. Il s’agissait du premier sexe masculin que la jeune fille voyait de sa vie, à l’exception des céramiques à figures rouges représentant des Dieux et des héros grecs. Le trouble de la servante augmenta davantage quand le corps du guerrier, à la façon d’un animal, se déploya sous ses yeux qu’elle cachait derrière la grille de ses doigts. Peu à peu, muscle par muscle, comme une fleur, le guerrier arménien s’éveilla. Lentement, il se mit à s’étirer, poussant des soupirs et des grognements de bête. Et soudain, il fut éveillé, ses yeux noirs mi ouverts. Demestis s’approcha lentement de lui, avec déférence, comme intimidée. Elle lui fit part des instructions de la reine. Mirigade se couvrit jusqu’à la moitié du torse en souriant.
« Peut-être aurez vous besoin d’un bain, monseigneur » suggéra Demestis. Mirigade approuva d’un hochement de tête, et, se glissa jusqu’à la pièce d’eau voisine. Tandis que deux esclaves égyptiennes faisaient couler de l’eau chaude dans son bain et allumaient de l’encens, Demestis attendait dans la chambre. Elle entendit soudain la voix du guerrier arménien chanter : il s’agissait de chants lancinants, prières antiques aux Dieux des montagnes du Caucase. Cette langue était certes primitive et gutturale, mais dans la bouche de Mirigade, et dans ce chant, elle était une main tendre qui étreignait le cœur de Demestis.
Quand il sortit, il trouva Demestis agenouillée. Il s’allongea sur le ventre. Demestis le trouva encore plus beau que lorsqu’elle était entrée dans la pièce, mélange d’Héraclès et de Darius. Elle prit alors place de part et d’autre des reins musclés du guerrier, et commença à le masser. Le dos, les épaules et les reins de Mirigade étaient durs, tendus. Par chaque fibre et chaque muscle que Demestis touchait, elle sentait le combat, le stress, la fatigue, en un mot la guerre, que l’Arménien avait accumulés depuis des semaines, des mois, des années peut-être. Elle en était émue. Elle se demandait depuis combien de temps cet homme n’avait pas connu un lit, plutôt qu’une tente, un vrai repas, plutôt que de l’eau et des galettes de farine. Pourtant, peu à peu, les membres de ce rude guerrier semblaient se détendre, presque s’affaisser sous les gestes experts et les caresses de Demestis. Elle massait à présent sa nuque, son corps de jeune fille tout serré contre le dos du guerrier qui, alangui par son récent réveil et la chaleur du bain, somnolait. Le cœur de la jeune fille palpitait, semblant vouloir jaillir à chaque pulsation de son opulente poitrine. Puis elle descendit à nouveau pour masser ses épaules, ses bras, revenant à nouveau au dos. Elle continua son périple, enfonçant délicatement ses doigts et ses paumes dans les reins de Mirigade, avant de masser plus vigoureusement les mollets, à la façon des athlètes. Puis elle lui demanda de se tourner sur le dos afin de masser correctement ses pieds. Ils étaient larges, sombres mais guère longs. Elle passa ses doigts sous la pulpe, la voute plantaire, puis apaisa les orteils de leur tension. A présent, Mirigade semblait proche du sommeil et ne réagissait presque plus. Sa respiration, tranquille et régulière, soulevait doucement son torse large.
Demestis se releva, prit ses sandales, et s’en alla sur la pointe des pieds, disparaissant dans le couloir avec un large sourire sur le visage.
********************
L’immense disque solaire noyait le palais de lumière et de chaleur. Demestis était en train de coiffer sa maitresse à l’aide d’un petit peigne en nacre. Elle sentait le regard discret de Davaman sur ses pieds nus. C’était comme si elle entendait ou sentait les battements hystériques du cœur du jeune oriental dans ses propres tempes. Elle trouvait ce petit jeu amusant.
Mirigade fit soudain son entrée. Inclinant brièvement la tête devant la reine en guise de salut, Demestis le vit adresser un regard à Davaman, dédaigneux et froid. Elle s’en étonna l’espace d’un moment, mais ne prit pas la peine d’y penser plus longuement. Elle retourna à son ouvrage, les épaisses boucles noires de sa maitresse filant comme la laine entre ses doigts. Mirigade s’approcha et tendit à la reine un morceau de papyrus. Elle le parcourut en silence, son visage se refermant peu à peu. Elle ordonna qu’on la laisse seule, et que tous pouvaient aller vaquer à leurs occupations ordinaires. En un instant, la pièce fut vide.
Demestis, quant à elle, au lieu de retourner dans sa chambre, suivit Mirigade, sur la pointe des pieds, se dissimulant parfois dans les coins de couloirs. L’impassible guerrier arménien était retourné à d’épais volumes de papyrus et à de grandes quantités de tablettes d’argile, en grec, en vieux persan et en assyrien. Il les parcourait d’un œil sérieux et presque sombre. La jeune fille entra dans sa chambre sans un bruit, comme un chat. Cependant, comme si le vétéran qu’il était avait senti sa présence, il se retourna immédiatement. Demestis réprima alors un cri de stupeur et de honte mêlées. Elle rougit de s’être ainsi faite surprendre. Il la parcourut avec curiosité, de haut en bas, comme un soldat jauge un adversaire avant un combat, comme un animal en examine un autre pour savoir s’il s’agit d’un prédateur ou d’une proie, en silence mais toujours à l’affut, les muscles en apparence détendus mais toujours prêts à bondir. Par enjambées lentes et timides, Demestis s’approcha de lui. Durant sa vie de guerrier, Mirigade avait affronté d’autres tribus de son pays, des Sarmates, des Perses, des Arabes, des Scythes, à pied, à cheval, à dos de chameau, à l’épée, à la lance, à l’arc, et parfois à mains nues. Il avait maints fois frôlé la mort. Et pour la première fois, le regard d’une jeune servante le déstabilisait, fendait son cœur. Non pas qu’il fusse amoureux – il n’avait jamais connu ce sentiment et n’aurait pu reconnaître ce sentiment – mais il sentait quelque chose agiter ses entrailles, comme le feu d’une lame chauffée au fond d’une forge. Bien sûr, il avait déjà vu d’autres femmes, de toutes races, dont celles qu’il avait déjà combattues, esclaves ou femmes libres, reines ou paysannes, parfois bien plus somptueusement parées que cette simple servantes. Mais Demestis était définitivement différente. Son regard le paralysait.
Quand Demestis fut tout à fait proche de lui, ils restèrent ainsi plus d’une minute à se regarder au fond de l’œil et du cœur, un peu bêtes, le souffle court, secoués de tremblements nerveux. Un peu maladroitement, Mirigade l’enlaça de ses bras noueux, comme un ours saisit le tronc de l’arbre dont il veut récolter le miel, saisissant la taille de la jeune fille. Ce fut pour elle comme un signal : elle s’affaissa presque, dévoilant sa bouche, sa gorge et sa poitrine sélénienne. Avec avidité, tel l’ours qu’il était, il la baisa de toute part, caressant ses cheveux, sa nuque, ses épaules, et la maintenant fermement par les reins. Ses doigts étaient plantés dans la chair fine de Demestis; c’en était presque douloureux, mais c’était pour elle comme une première ivresse. Elle voulait boire beaucoup, à grandes gorgées, quitte à ce que lui tourne la tête. Elle sentait les doigts épais et étonnamment délicats de Mirigade dans ses cheveux et dans son dos. Ses mains trouvèrent ensuite les fesses de Demestis, les empoignant à travers le lin. Elle eut un frisson dans le dos, se serrant encore plus contre Mirigade. Ce couple improbable n’écoutait à présent plus que ses coeurs et ses instincts joints. Il se baissa peu à peu, dégageant la lourde poitrine de Demestis, et se mit à la couvrir de baisers avides, tantôt lourds, tantôt délicats. Parfois, il mordillait la peau couleur de lait de Demestis qui poussait des petits soupirs ou des cris de surprise qu’elle réprimait d’une main devant la bouche. Mirigade passa alors la langue autour des tétons durcis de la jeune fille, qui sentit des vagues de chaleur inonder dans sa poitrine, couler jusque dans son ventre. Cette sensation absolument nouvelle lui donnait l’impression que ses jambes étaient faibles, et qu’elle allait s’évanouir. Mirigade se mit alors à genoux, étreignant lui étreignant les reins et baisant son ventre, son nombril. Demestis gémit, enfonçant ses ongles dans les cheveux puis les épaules du guerrier arménien. Il resta un moment ici, profitant de la chaleur et de la vie qu’il sentait de l’autre côté de la mince couche de lin de la robe qu’il avait écartée pour faire passer sa bouche. Il en écarta encore un pan, avant de lever une jambe de la jeune fille, la posant sur son épaule. Elle réprima un nouveau cri de surprise. Puis Mirigade posa ses lèvres douces sur sa fleur délicate. Elle était absolument nue, sans poil, et Demestis accueillit la barbe drue avec un mélange de curiosité, de plaisir et d’inquiétude. C’était un peu piquant, un peu rugueux, et doux tout à la fois. Puis Mirigade se mit à parcourir toute cette zone de ses baisers, avec fougue et délicatesse mêlées. Demestis avait chaud et avait aussi un peu honte, exposée qu’elle était pour la première fois devant un homme. Mais ce dernier sentiment disparu lorsque Mirigade se mit à poser des petits baisers sur la chair tendre de Demestis. Puis il se mit à caresser les pétales de Demestis, par à coups délicats, lui arrachant des soupirs saccadés. Il insinua peu à peu sa langue en elle, avec tendresse, quoiqu’un peu maladroitement par moments, avant de remonter. Il accéléra ses caresses, cependant que Demestis devenait plus agitée et haletante. Elle réprima un cri en mordant son poing avec force et en enfonçant les ongles de son autre main dans l’épaule de Mirigade, avant de se laisser tomber. Il bondit pour la rattraper, et la prit dans ses bras pour la coucher dans son lit. Elle gisait là, à moitié nue, comme une morte, un sourire aux lèvres, un souffle régulier soulevant sa lourde poitrine. Il s’allongea à ses côtés, et la contempla comme on admire la statue d’une déesse juste avant de prier. Il n’osait la toucher; non pas qu’il pensât à une quelconque conséquence, car il était trop ivre du bonheur qu’il venait de boire au fruit de Demestis, mais parce qu’il était à nouveau frappé du même sentiment lumineux que quand elle était entrée dans sa chambre quelques minutes auparavant. Enfin cependant, il osa : il passa deux doigts dans les longs cheveux de la jeune fille, le cœur tout à la fois pétrifié et battant la chamade, comme s’il voulait faire voler en éclats sa poitrine. Dans son sommeil, elle se retourna vers lui, en position fœtale. Sa stupeur n’en fut que plus grande. Il ne savait plus que faire, à présent. Il aurait aimé tout à la fois la réveiller, l’enlacer, et la couvrir de baisers. Un peu gauchement, il se colla à elle. Le nez dans ses cheveux d’ébène, il pouvait respirer à pleins poumons son odeur. Bercé par cette odeur de paradis, il sombra dans un profond sommeil.
****************
Les deux amants furent réveillés par l’arrivée de la reine, accompagnée de Davaman et d’un autre garde, et de deux servantes. Son visage fermé semblait manifester davantage de déception que de colère. En voyant sa maitresse la toiser ainsi, Demestis se mit à trembler comme une feuille. Sachant qu’il était inutile de tenter de s’expliquer, elle se rhabilla en hâte et se jeta à ses pieds sans dire un mot. Mirigade, quant à lui, demeura sur le bord du lit, rouge de honte, tête baissée, les mains croisées sur les cuisses. La reine les regarda tous les deux pendant une minute entière, l’un puis l’autre. Puis elle ordonna d’un ton froid et égal que Demestis fût raccompagnée à sa chambre par les servantes et le garde, un gigantesque Macédonien aux cheveux blonds et bouclés et au visage balafré. Elle aurait pour consigne de ne pas en sortir sauf autorisation spéciale et expresse de la reine, et ne devrait recevoir personne, sauf la reine elle-même ainsi que les servantes pour son linge, et sa nourriture. Pour Mirigade, voir Demestis disparaître ainsi dans le couloir, emmenée, volée, les larmes aux coins des yeux, ce fut un véritable déchirement du cœur. Cependant, il ne dit rien, se contentant de serrer les dents. Il savait que son statut le protégeait d’une sanction qu’il aurait eu à subir si par malheur le roi avait été présent à ce moment-là.
A présent, sa chambre lui semblait immense et vide. Seul l’environnait le souvenir fugace et délicieux des mains de Demestis dans ses cheveux et sur ses épaules, de l’odeur de sa féminité roulant sur sa langue jusque dans sa gorge, de son sourire lumineux et timide. Et cette brûlure béante en plein milieu de l’esprit et du cœur qui ne semblait pouvoir s’éteindre ni se refermer; Mirigade était à présent certain que quelque chose de nouveau était en train de naître en lui.
Il fit appeler les deux esclaves égyptiennes et ordonna qu’on lui fasse couler un bain. Pendant que l’on s’affairait dans l’autre partie de sa chambre, il se mit à genoux devant le petit autel de celle-ci, face à l’est. Et là, à mi voix, il se mit à prier Anahit, qui préside aux amours arméniennes. Il l’interrogeait, la questionnait, et ce pour la première fois, lui qui n’avait de toute sa vie de guerrier prié que Aramazd, Mir et surtout Haldi, le dieu de la guerre. Il avait allumé de l’encens de son pays qui bientôt avait empli la pièce de lourdes volutes pourpres et grises.
L’une des deux esclaves vint le chercher : son bain était prêt. Il ôta sa tunique, sans pudeur, comme un soldat qui a l’habitude d’être nu parmi ses camarades, devant ses supérieurs, devant les esclaves des deux sexes. Il entra dans l’eau brûlante. Il sentit bientôt ses muscles se détendre, sa tension nerveuse, ses angoisses se diluer en elle. Mais toujours restait en lui ce nom : Demestis.
****************
Demestis se morfondait : on venait de lui ôter la première saveur, la première nouveauté qu’elle connaissait depuis son enfance. Toute sa vie n’avait été que service. Certes, elle avait toujours été heureuse, choyée, protégée, nourrie, habillée, et n’avait jamais manqué de rien. Mais Mirigade lui avait pour la première fois apporté quelque chose d’autre : le dévouement. Ce même dévouement qu’elle offrait à la reine Bérénice, cette fidélité, cette loyauté, elle l’avait enfin retrouvé, sous une autre forme certes, dans le regard et dans les bras de ce rude combattant des montagnes du Caucase. Elle l’avait deviné dès la première fois qu’elle l’avait vu, et la brève étreinte qu’ils avaient eue n’avait fait que confirmer ses attentes et ses désirs. Soudain, alors que ses yeux étaient tout à fait noyés de larmes, le pas léger de la reine se fit entendre. Quoique tout à fait chez elle y compris dans la chambre de sa suivante, elle semblait attendre à l’entrée que celle-ci l’invite à entrer, comme si elle en respectait le chagrin. Quand elle l’eut remarqué, Demestis se redressa de son lit et se présenta à genoux devant sa maîtresse. Bérénice entra alors, s’approchant jusqu’à elle, et, la relevant, elle la prit par les épaules. Demestis fut perturbée, bouleversée par ce geste d’affection, surtout en pareilles circonstances.
« Ce que vous avez fait avec Mirigade n’est pas une offense en soi à ma personne ni à celle du roi. Mais songez tous les deux que ce palais grouille d’intrigants, et peut-être d’ennemis, qui pourraient vouloir, par vous ou par lui, m’atteindre, et donc atteindre notre roi. Cette histoire, si histoire il y a, est dangereuse ». A présent, elle regardait Demestis d’un air plus doux, plein de compassion et même de pitié. Demestis quant à elle se sentait abattue, vide et molle. Mille pensées se bousculaient dans sa tête. Elle murmura un mélange d’excuses et de remerciements, ne sachant quoi dire d’autre. Puis Bérénice continua : « Je vais me retirer. Dans un moment, votre ami Davaman va venir avec une servante. Ils vous apporteront du linge frais, ainsi qu’un copieux repas. Je crois que vous en avez besoin ». Elle accompagna cette dernière phrase d’un sourire en coin qui fit rougir Demestis jusqu’aux oreilles, ce que la reine eut la bonté de feindre de ne pas remarquer. Elle tourna les talons et disparut dans le couloir.
Bientôt, Davaman entra accompagné d’une autre servante. Celle-ci portait non sans difficulté un immense plateau de fruits, tandis que Davaman portait une œnoché d’eau et une de vin. Demestis prit alors conscience, comme la reine l’avait prévu, qu’elle était en effet tout à fait affamée. La servante se retira à petits pas discrets tandis que Demestis se jetait sur la nourriture, les figues en particulier, dont Demestis était particulièrement friande, sous le regard amusé de Davaman. De ses doigts agiles, elle ouvrait les fruits, en faisait sortir la pulpe rougeâtre, et y plongeait, lèvres et langue en avant. Et le guerrier mauryan observait cet étrange et délicieux spectacle, les longs cheveux de la jeune fille dansant dans la lumière du matin, les figues disparaissant une à une dans sa bouche avec un bruit charmant et sensuel, le jus rose coulant sur ses doigts. De temps en temps, discrètement, il ne pouvait s’empêcher de regarder les petits pieds blancs de Demestis. Il les connaissait par cœur, en ayant mémorisé chaque aspect, chaque pli, chaque rondeur, de la pulpe au talon, comme un vieux prêtre connait toutes les prières de son Dieu.
Quand Demestis eut mangé la moitié du plateau de fruits, elle s’étendit sur le lit, en croix. Puis elle jeta un œil malicieux et complice à Davaman : « Davaman, mon ami, veux tu bien me masser les pieds ? ». Il en eut le souffle coupé comme s’il venait de recevoir un coup à l’estomac. Il ôta son manteau, et se mit à genoux, silencieusement. Elle lui présentait déjà ses pieds. Il en saisit le gauche, et se mit à l’ouvrage. A dire vrai, il avait déjà fait ces gestes mille fois en rêve, et était à présent comme à l’exercice. La pratique lui était tout à la fois familière et nouvelle, banale et merveilleuse. Et au travers de ses pieds, il la sentait se détendre, et un peu, un tout petit peu, lui appartenir. Bien entendu, il n’ignorait pas que s’il se trouvait en ce moment à ses pieds, en train de lui prodiguer ces caresses, c’était en raison de la punition infligée par la reine à son amie, et il n’ignorait pas non plus le motif de la punition. Cette pensée le mit brièvement en colère, la jalousie le submergea, comme le venin de l’aspic envahit les veines et les muscles de sa victime. Mais il chassa vite ces pensées sombres en se concentrant sur le plaisir et le bonheur qu’il avait de masser les pieds délicats de Demestis. Ils semblaient fondre et se reformer immédiatement ensuite à chacune de ses caresses, de ses pressions, sous les orteils, sous la pulpe, au talon. Davaman constata soudain que Demestis dormait profondément, d’un sommeil apaisé. Il prit alors ses jambes et les posa délicatement sur le lit avant de sortir de la chambre doucement.
****************
Demestis se réveilla avec une envie de boire toute l’eau du fleuve Oxus. Elle se servit plusieurs coupes et but, avec avidité. Mais cette soif naissait plus profondément que dans sa gorge : la sécheresse était au fond de ses entrailles et de son cœur. Alors, elle but aussi du vin. Mais cette sécheresse était celle de la mélancolie. Elle compris ce qui seul pourrait apaiser sa soif : Mirigade. Elle n’avait pu qu’effleurer seulement le plaisir et le bonheur à son contact, et pourtant elle savait que c’était cette eau qui devait et pouvait l’apaiser.
Elle écrivit un petit mot sur un morceau de papyrus pour la reine. Elle y suppliait sa maîtresse de pouvoir recevoir son amant – puisque le sort avait décidé de lier ces deux êtres sous ce vocable – au moins une fois par semaine, dans sa chambre. Elle fit appeler une servante, qui disparut avec le message.
Puis elle attendit pendant des minutes qui lui parurent des heures. Elles faisait les cent pas, tordant nerveusement ses doigts et ses poignets, mordant sa lèvre inférieure. Déjà le soleil était haut et brûlant. Ne voyant pas de réponse arriver, elle s’assit sur son lit. Au bout d’une heure, elle s’y allongea, s’y tournant et s’y retournant en tout sens. Puis vint le soir, qui s’étirait en longueurs moites et lourdes sur toute la région en cette saison. A la tristesse vint s’ajouter chez Demestis l’ennui. Allongée sur le ventre, elle laissait se balancer son bras dans le vide, le regard dans le vague. Un chat entra bientôt à pas silencieux, le regard de biais, pour venir se frotter contre la main. La jeune fille se mit à lui caresser la tête, la nuque, jusqu’à ce que l’animal se courbe de contentement. Elle le prit délicatement et le posa tout contre elle. Il se roula en boule, et se mit à ronronner, et resta avec elle jusqu’à ce qu’elle confit sa mélancolie à la nuit.
****************
Elle fut réveillée par la sensation de doigts dans ses cheveux. Ouvrant un œil puis l’autre, elle faillit crier de surprise en voyant Mirigade assis sur le rebord du lit qui la regardait tendrement. Le soleil était loin d’être levé. Il lui expliqua alors comment, au milieu de la nuit, la reine lui avait fait parvenir un message. Les deux amants avaient le droit de se voir, une fois par semaine, hors de vue des habitants du palais, et tant que le jour n’était pas levé. Si l’une de ces règles n’était pas respectées, des sanctions seraient prises. Demestis se jeta à son cou, se blottissant contre lui, lui baisant la nuque, les épaules, le torse, les bras, puis les mains, avant de le regarder longuement au fond des yeux. Elle glissa une main sous la tunique du guerrier, comme guidée par une force inconnue, et l’embrassa fougueusement. Elle senti les bras de l’Arménien l’enlacer à la fois doucement et fermement, tandis que sa main trouvait le membre déjà dur et gonflé de son amant. Le poussant sur le lit, jambes écartées, elle le déshabilla en quelques gestes. Cette nuit, il n’était plus le farouche guerrier, qui avait parcouru tant de champs de batailles du Caucase à l’Arabie, de la Cappadoce à l’Indus, il était un homme subjugué par son regard, par sa poitrine lourd, par ses jambes immenses, par sa peau de lait. Il aimait cela, et elle le lisait dans son regard, aussi clairement qu’un lac de montagne. Elle prenait son temps, avec des gestes qu’elle voulait sensuels mais qui restait un peu maladroits et inexpérimentés, pour se déshabiller elle aussi, dégager ses seins immenses, son ventre, ses cheveux. Puis elle se coucha sur lui pour entendre les battements de son cœur quelques instants, et se mit à le couvrir de caresses et de baisers. Peu à peu, ses lèvres descendirent de son torse à son ventre, lui arrachant des soupirs, des grognements, tandis qu’elle tenait d’une main son membre. Il était épais, gonflé, veineux, et sombre. Sa base en était couverte de poils drus et frisés, et l’odeur en était étrange, un peu âcre. Doucement, elle posa ses lèvres dessus, reproduisant là une discussion entre deux servantes surprise le mois dernier. Elle se mit à le parcourir de haut en bas, de bas en haut, de ses lèvres délicates, avant de sortir sa langue. Elle le léchait, comme elle le faisait parfois avec un sorbet, caressant les deux bourses qui, de plus en plus, durcissait dans sa petite main. Mirigade semblait avoir quitté cette réalité, et gémissait, soufflait, grognait, ses doigts plongés dans les cheveux de Demestis. Bientôt, celle-ci avala le vit de son amant, avec difficulté. Elle s’étouffa, toussa, cracha un peu, puis recommença, avec plus de lenteur et de méthode. Mirigade semblait apprécier, tant il gémissait fort. Au bout d’un moment, elle cessa, et, sans qu’elle eût pu dire un mot, il reprit ses esprits; il la prit dans ses bras, la coucha sur le côté et glissa ce membre épais en elle. Demestis ferma les yeux et se mordit la lèvre inférieure, tant la sensation différait de ce qu’elle connaissait : c’était à la fois plus gros que ces doigts, plus profond, plus intense, mais, étrangement, pas forcément meilleur. En quelques secondes, elle analysa ceci, mais n’eut pas le temps d’être déçue. Bientôt, elle sentit son amant entrer dans son corps et dans son âme, l’une de ses mains tenter vainement d’empoigner son sein immense. Puis cette main descendit, caressa un peu son ventre, tandis qu’il baisait son cou et ses cheveux. Peu à peu, le membre de Mirigade se logeait en elle, diffusant une douce sensation de chaleur et de plaisir bientôt amplifiée par les caresses qu’il se mit à lui prodiguer sur son petit bouton de rose qui était si gonflé qu’il semblait vouloir sortir. Demestis gémissait à son tour, elle semblait vouloir hurler; alors il lui fit mordre son bras, ce qu’elle fit, férocement, avidement, amoureusement. Ses sens et ses sentiments se mélangeaient dans sa tête, dans son ventre et dans son cœur, tandis que leurs sueurs et leurs souffles ruisselaient le longs de leurs jambes, de leurs torses et de leurs dos.
Quand Demestis revint à elle, elle se demanda si tout ceci n’avait pas été un rêve. Ne restait en elle qu’une merveilleuse sensation de bonheur. Dehors, le soleil commençait à poindre : il était temps de se mettre au travail pour la reine Bérénice.